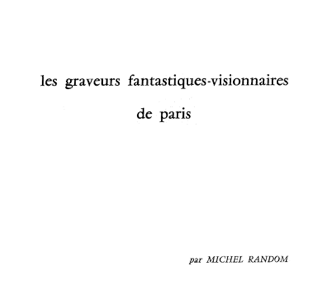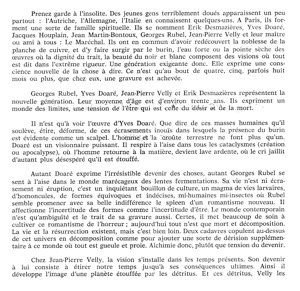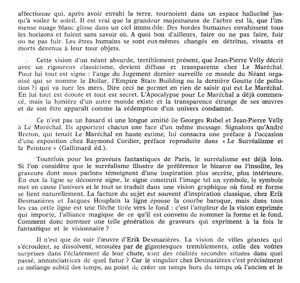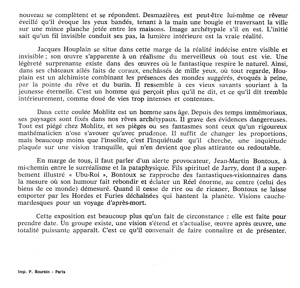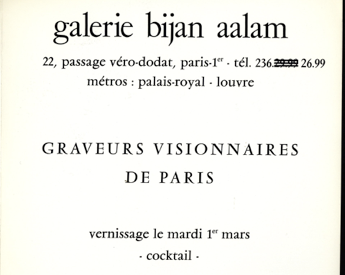Prenez garde à l’insolite. Des jeunes gens terriblement doués apparaissent un peu partout : l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie en connaissent quelques-uns. A Paris, ils forment une sorte de famille spirituelle. Ils se nomment Erik Desmazières, Yves Doaré, Jacques Houplain, Jean Martin-Bontoux, Georges Rubel, Jean-Pierre Velly et leur maître ou ami à tous : Le Maréchal. Ils ont en commun d’avoir redécouvert la noblesse de la planche de cuivre, et d’y faire surgir par le burin, l’eau forte ou la pointe sèche des oeuvres où la dignité du trait, la beauté du noir et blanc composent des visions où tout est dit dans l’extrême rigueur. Une génération exigeante donc. Elle exprime une conscience nouvelle de la chose à dire. Ce n’est qu’au bout de quatre, cinq, parfois huit mois ou plus, que chez eux, une gravure est achevée.
Georges Rubel, Yves Doaré, Jean-Pierre Velly et Erik Desmazières représentent la nouvelle génération. Leur moyenne d’âge est d’environ trente ans. Ils expriment un monde des limites, une « tension de l’être » qui est celle du désir et de la mort.
Il n’est qu’à voir l’oeuvre d’Yves Doaré. Que dire de ces masses humaines qu’il soulève, étire, déforme, de ces écrasements inouïs dans lesquels la présence du burin est évidente comme un scalpel. L’homme et la croûte terrestre ne font plus qu’un.
Doaré est un visionnaire puissant. Il respire à l’aise dans tous les cataclysmes (création ou apocalypse), où l’homme retourne à la matière, devient lave ardente, où le cri jaillit d’autant plus désespéré qu’il est étouffé.
Autant Doaré exprime l’irrésistible devenir des choses, autant Georges Rubel se sent à l’aise dans le monde marécageux des lentes fermentations. Sa vie n’est ni écrasement ni éruption, c’est un inquiétant bouillon de culture, un magma de vies larvaires, d’homoncules, de formes équivoques et indécises, mi-humaines mi-insectes où Rubel semble promener avec sa belle indifférence le spleen d’un romantisme nouveau. Il affectionne l’incertitude des formes comme l’incertitude d’être. Le monde contemporain n’est qu’ambiguïté et le trait de sa gravure aussi. Certes, il met beaucoup de soin à cultiver ce romantisme de l’horreur; aujourd’hui tout n’est que mort et décomposition.
La vie et la résurrection existent, mais c’est bien loin. Deux cadavres copulent au-dessus de cet univers en décomposition comme pour ajouter une sorte de dérision supplémentaire à ce monde où tout est gueule et proie. Alchimie donc, plutôt que tension du devenir.
Chez Jean-Pierre Velly, la vision s’installe dans les temps présents. Son devenir à lui consiste à étirer notre temps jusqu’à ses conséquences ultimes. Ainsi il développe l’image d’une planète étouffée par les détritus. Et ces détritus, Velly les affectionne qui, après avoir envahi la terre, tournoient dans un espace halluciné jusqu’à voiler le soleil. Il est vrai que la grandeur majestueuse de l’arbre est là, que l’immense nuage blanc glisse dans un ciel immuable. Des hordes humaines envahissent tous les horizons et fuient sans savoir où. A quoi bon d’ailleurs, faire ou ne pas faire, fuir ou ne pas fuir. Les êtres humains se sont eux-mêmes changés en détritus, vivants et morts devenus à leur tour objets.
Cette vision d’un néant absurde, terriblement présent, que Jean-Pierre Velly décrit avec un rigoureux classicisme, devient diffuse et transparente chez Le Maréchal. Pour lui tout est signe : l’ange du Jugement dernier surveille ce monde du Néant organisé qui se nomme le Dollar, l’Empire State Building ou la dernière Goutte (de pollution?) qui va tuer les mers. Dire ceci ne permet en rien de saisir qui est Le Maréchal. En lui tout est écoute et tout est secret. L’Apocalypse pour Le Maréchal a déjà commencé, mais la lumière d’un autre monde existe et la transparence étrange de ses œuvres et de son être apparaît comme la rédemption d’un univers condamné.
Ce n’est pas un hasard si une longue amitié lie Georges Rubel et Jean-Pierre Velly à Le Maréchal. Ils apportent chacun une face d’un même message. Signalons qu’André Breton, qui tenait Le Maréchal en haute estime, lui consacra une préface à l’occasion d’une exposition chez Raymond Cordier, préface reproduite dans « Le Surrealisme et la Peinture » (Gallimard ed.).
Toutefois pour les graveurs fantastiques de Paris, le surréalisme est déjà loin.
Si l’on considère que le surréalisme illustre de préférence le bizarre ou l’insolite, les graveurs dont nous parlons témoignent d’une inspiration plus secrète, plus intérieure.
En eux la ligne se découvre signe, le signe construit l’image tel un symbole, le symbole met en cause l’univers et le tout se traduit dans une vision graphique où fond et forme se lient naturellement. La facture du sujet est souvent d’inspiration classique, chez Erik Desmazières et Jacques Houplain la ligne épouse la courbe baroque, mais dans tous les cas cette ligne est une flèche tirée vers le fond : c’est l’ampleur de la vision exprimée qui importe, l’alliance magique de ce qu’il est convenu de nommer la forme et le fond.
Comment donc nommer une telle génération de graveurs qui expriment à la fois le fantastique et le visionnaire ?
Il n’est que de voir l’oeuvre d’Erik Desmazières. La vision de villes géantes qui s’écroulent, se dissolvent, secouées par de gigantesques tremblements, celle des voûtes surprises dans l’éclatement de leur chute, sont des réalités secondes situées dans quel passé, annonciatrices de quel futur ? Car le singulier chez Desmazières c’est précisement ce mélange subtil des temps, au point de créer un temps hors du temps où l’ancien et le nouveau se complètent et se répondent. Desmazières est peut-être lui-même ce rêveur éveille qu’il évoque les yeux bandés, tenant à la main une bougie et traversant la ville sur une mince planche jetée entre les maisons. Image archétypale s’il en est. L’initié sait qu’un fil invisible conduit ses pas, la lumière intérieure est la vraie réalité.
Jacques Houplain se situe dans cette marge de la réalité indécise entre visible et invisible; son oeuvre s’apparente à un réalisme du merveilleux où tout est vie. Une légèreté surprenante existe dans des oeuvres où le fantastique respire le naturel. Ainsi, dans ses châteaux ailes faits de coraux, enchâssés de mille yeux, où tout regarde, Houplain est un alchimiste combinant les présences des mondes suggérés, évoqués à peine, par la pointe du rêve et du burin. Il ressemble à ces vieux savants souriant à la jeunesse éternelle. C’est un homme qui perçoit plus qu’il ne dit, et ce qu’il dit tremble intérieurement, comme doué de vies trop intenses et contenues.
Dans cette coulée, Mohlitz est un homme sans âge. Depuis des temps immémoriaux, ses paysages sont fixés dans nos rêves archétypaux. Il grave des évidences dangereuses.
Tout est piège chez Mohlitz, et ses pièges ou ses fantasmes sont ceux qu’un rigoureux mathématicien n’ose s’avouer qu’avec prudence. Il suffit de changer les proportions, mais beaucoup moins que l’insolite, c’est l’inquiétude qu’il cherche, une inquiétude plaquée sur une vision tranquille, qui n’en devient que plus attirante ou redoutable.
En marge de tous, il faut parler d’un alerté provocateur, Jean-Martin Bontoux, à mi-chemin entre le surréalisme et la pataphysique. Fils spirituel de Jarry, dont il a superbement illustré « Ubu-Roi », Bontoux se rapproche des fantastiques-visionnaires dans la mesure où son humour fait rebondir et éclater un Réel énorme, au centre (celui des biens de ce monde) démesuré. Quand il cesse de rire ou de ricaner, Bontoux se laisse emporter par les Hordes et Furies déchaînées qui hantent la planète. Visions cauchemardesques pour un voyage d’après-mort.
Cette exposition est beaucoup plus qu’un fait de circonstance : elle est faite pour prendre date. Un groupe existe, une vision s’étend et s’actualise, oeuvre après oeuvre, une totalité puissante apparaît. C’est ce qu’il convenait de faire connaître et de présenter.